Un texte instructif de Jean-Pierre Tertrais, introduction à la soirée-débat du 13 janvier 2012.
L’accaparement des terres par l’agriculture industrielle
Intervention de Jean-Pierre tertrais, groupe La Sociale (Fédération Anarchiste- Rennes) – La vidéo
Conférence Vannes janvier 2012 : accaparement des terres
Selon le dictionnaire, «accaparer», c’est acquérir ou conserver en grande quantité pour faire monter le prix, détenir le monopole, conserver pour son usage exclusif. Ce qui est au cœur du phénomène d’accaparement, c’est donc bien la propriété privée. Cette propriété privée n’est pas une loi naturelle comme tentent de nous le faire croire les libéraux, mais le produit d’une longue évolution culturelle, et notamment de la division du travail. Elle permet l’accumulation de biens et définit des relations sociales en divisant la société en riches et en pauvres.
S’agissant de la terre, le communalisme tribal a fonctionné des millions d’années. Pendant longtemps la propriété revient aux communes, et les champs sont exploités par les paysans locaux qui profitent ensemble des récoltes. Le capitalisme va favoriser l’appropriation des terres en trois étapes essentielles.
Première étape : les enclosures
On appelle mouvement des enclosures les changements qui, dès le 12e siècle mais surtout à partir de la fin du 16e et au 17e siècle, ont transformé, dans certaines régions de l’Angleterre, une agriculture traditionnelle dans le cadre d’un système de coopération et communauté d’administration des terres en système de propriété privée des terres (chaque champ étant séparé du champ voisin par une barrière, voire un bocage). Les enclosures marquent la fin des droits d’usage, en particulier des communaux, dont bon nombre de paysans dépendaient.
Plusieurs raisons sont invoquées pour justifier ce qu’on peut appeler un vol :
° l’absence de cadastre nécessitait, pour les accapareurs, de matérialiser les limites foncières ;
° les haies permettaient de parquer les animaux et de se protéger des bêtes errantes ;
° ces haies, les fossés, les talus sur lesquels elles sont plantées, assurent plusieurs fonctions écologiques, et même économiques : régulation et drainage de l’eau, protection contre le vent, production d’arbres fruitiers, de bois de chauffage.
Mais la raison principale est la suppression des droits d’usage (vaine pâture, communaux).
Ce mouvement s’accompagne le plus souvent de l’utilisation de nouvelles techniques (rotations), de nouvelles cultures. Il est souvent présenté comme le moyen permettant de passer d’une agriculture jugée peu productive à une agriculture plus intensive. C’est pourquoi il peut être considéré comme une première étape dans la construction du capitalisme, du développement économique. Les champs ouverts et les pâturages communs ont en effet été convertis par les riches propriétaires fonciers en pâturages pour des troupeaux de moutons, pour le commerce de la laine alors en pleine expansion.
Il n’est donc pas surprenant que la naissance du capitalisme engendre aussitôt des conséquences sociales négatives : la richesse des uns s’établit sur la misère des autres. Dans l’immédiat, cette appropriation d’espaces préalablement dévolus à l’usage collectif a supprimé les possibilités de pacage et de glane à l’ensemble des habitants. Beaucoup de paysans seront, par la suite, progressivement privés de leurs terres de toutes sortes de manières : non-renouvellement des baux à durée limitée, reprise des terres au moment des décès et des mutations, évictions abusives… Ainsi la majorité de la petite paysannerie se trouvera réduite au salariat agricole ou industriel, à la mendicité, à l’exode vers les villes. Très vite, une grande partie de la terre se trouve aux mains d’un nombre réduit de grands propriétaires.
Le même phénomène se déroulera un peu partout, avec des modalités et des rythmes différents. La noblesse française, contrairement à l’aristocratie d’Outre-Manche, ne s’est pas tournée vers l’agriculture commerciale, fondée sur de grandes fermes employant des salariés agricoles. Pour l’essentiel, les grands gagnants de la redistribution effectuée à la suite de la confiscation des biens de l’église et d’une partie de la noblesse, sont la couche « moyenne » de deux à trois millions de personnes : paysans aisés, bourgeois agraires.
En favorisant l’accès à la propriété individuelle au détriment des solidarités communales antérieures et de la gestion collective des espaces villageois, la réforme agraire réduit les bases de survie de ceux qu’on appellerait aujourd’hui les « paysans sans terre » : la grande masse des manœuvres, domestiques, saisonniers qui représentent environ dix millions de personnes, auxquelles il faut ajouter le million de vagabonds et de mendiants parcourant villes et campagnes. Il faudra attendre 1881 pour que soient votés les premiers textes du code rural, et 1946 pour avoir un statut du fermage.
Dans le même registre, on peut aussi évoquer la déportation des Indiens d’Amérique qui résulta d’une loi datant du 26 mai 1830, et qui répondait à la soif toujours plus grande d’espaces de la part des Blancs. Cette loi ordonnait le déplacement des Indiens vivant dans les territoires compris entre les treize Etats fondateurs et le Mississipi, vers une région située à l’ouest du fleuve. Au moins 60 000 Amérindiens ont été concernés, plusieurs milliers sont morts de faim (hécatombes de gibier : plus de dix millions de bisons abattus entre 1872 et 1874), de maladie (choléra, variole…), d’épuisement, de froid, ou par les armes à feu. Comme disait un chanteur canadien, des Amérindiens, de plus en plus amers, de moins en moins indiens.
C’est cette présence insupportable des Indiens pour les nouveaux arrivants qui engendrera le plus souvent un engrenage infernal pour les Indiens : proposition de traités, non-respect de ces traités par les Blancs, colère des Indiens, écrasement militaire et confinement dans des réserves.
Deuxième étape : la course à l’agrandissement
Vers le milieu des années 1950, un ministre américain de l’agriculture lançait cet avertissement aux membres de la profession : « Agrandissez-vous ou déguerpissez ». Par sa nature même, le système capitaliste ne peut fonctionner qu’à grande échelle. Il fallait donc de grandes, si possible de très grandes exploitations pour vendre des machines toujours plus puissantes et sophistiquées, et des quantités toujours plus importantes d’engrais et de pesticides.
Favorisée par un potentiel exceptionnel en matière de relief, de climat, de ressources, de sols et par des exploitations de taille moyenne déjà plus élevée qu’en Europe, l’agriculture américaine passe très rapidement la vitesse supérieure : grandes monocultures, nouvelle génération de chefs d’entreprises disposant des technologies les plus récentes. Dans plusieurs régions, une seule personne peut gérer efficacement une exploitation dépassant 400 ha. Le résultat, c’est que le nombre des exploitations agricoles américaines, qui s’élevait à 5 830 000 en 1950 passe à 3 900 000 en 1960, à 2 900 000 en 1970, à 2 400 000 en 1980, à 2 200 000 en 1990. La superficie moyenne des exploitations est passée de 85 ha en 1950 à 190 ha en 1990 (en sachant que les plus importantes, supérieures à 400 ha, occupaient 63,4 % de la superficie agricole utile en 1990).
Il faut, bien entendu, rappeler que le terrain avait été largement défriché par les conséquences de la Grande dépression. La terre appartenait alors essentiellement à quelques gros propriétaires et surtout à des sociétés anonymes ou des banques. La sécheresse et les tempêtes de poussière qui, pendant une dizaine d’années, avaient détruit les récoltes et érodé les terres, obligèrent près de trois millions de personnes à quitter leurs terres et ne feront qu’accélérer l’éviction programmée des fermiers. Le regroupement des terres permettra la mécanisation et la division du nombre d’exploitants par douze à quinze.
Cette course à l’agrandissement n’a évidemment pas lieu seulement aux Etats-Unis. Au Canada, en Australie, en Argentine, on observe un doublement de la superficie moyenne des exploitations agricoles en un tiers de siècle. En France, la taille moyenne passe de 16ha en 1950 à 34ha en 1990. Mais surtout, la part des très grandes (plus de 50ha) s’accroît rapidement. La surface totale des terres agricoles étant plutôt en régression (à cause de l’urbanisation notamment, c’est l’équivalent d’un département, en France, qui disparaît tous les dix ans), si certaines exploitations s’agrandissent, c’est que d’autres diminuent…ou disparaissent. Ainsi, la France comptait 2 300 000 exploitations en 1950, 1 600 000 en 1970, 1 200 000 en 1980, 960 000 en 1990, 700 000 en 2000, environ 450 000 aujourd’hui.
Il fallait mettre en place des moyens fiables pour éliminer régulièrement une partie des agriculteurs. Lorsque De Gaulle revient au pouvoir en 1958, deux experts, Louis Armand et Jacques Ruef, remettent au chef de l’Etat leur rapport pour jeter les bases d’une nouvelle expansion économique, et faire de la France une grande puissance industrielle. Heureuse coïncidence : l’industrie aura besoin de plus en plus de main-d’oeuvre, l’agriculture… de moins en moins.
Le rapport en question exprimait précisément : « Le mécanisme des prix ne remplira son office dans le secteur agricole qu’en infligeant aux agriculteurs, presque en permanence, un niveau de vie sensiblement inférieur à celui des autres catégories de travailleurs ». L’objectif était clair : favoriser ceux dont le système avait besoin, les exploitations performantes, capables financièrement de s’équiper en matériels et produits vecteurs de modernisation ; rendre les conditions de travail des autres, les futures victimes, de plus en plus difficiles.
Ainsi, divers instruments vont être façonnés pour opérer cette monstrueuse discrimination :
° Les prêts accordés par le système bancaire, notamment le Crédit Agricole, ne sont pas identiques pour tous. Ceux qui disposent au départ d’une situation plus confortable, ceux qui se trouvent bien en cour dans le monde des notables, ceux qui disposent d’appuis politiques sûrs, ceux qui acceptent de s’engouffrer dans la voie de la modernisation, de l’intensification, de la spécialisation, c’est-à-dire de se plier aux impératifs des sociétés multinationales… ceux-là obtiennent des prêts avantageux.
° L’attribution des multiples aides, primes, subventions ouvre la porte à toutes les discriminations. Parce que les aides sont liées à la surface, on conforte ainsi des situations acquises. C’est le développement inégal cumulatif. Les exploitations de grandes cultures, céréales et oléo-protéagineux, se taillent la part du lion. Ainsi, près de 80% des aides iront aux 20% des agriculteurs déjà les plus favorisés.
° Le remembrement, ou réaménagement foncier, renforcera cette « épuration » : pratiques de passe-droits qui lèsent les propriétaires les moins bien armés, système de copinage, intimidation, partialité de la commission des litiges… C’est souvent au détriment des mêmes personnes que les injustices se cumulent : terres plus éloignées ou de qualité inférieure, perte de points d’eau, de surfaces boisées…
° Le laxisme et même la complicité des pouvoirs publics permettent aux moins scrupuleux de conquérir des parts de marché, pénalisant ceux qui respectent la réglementation. Ainsi, 40% de la production porcine en Bretagne s’est faite au-delà des autorisations légales.
Quand on établit son bilan, la face cachée de la modernisation de l’agriculture ressemble à un cauchemar. En moins d’un demi-siècle, l’agriculture productiviste a hypothéqué les ressources en eau, mis en péril la santé des agriculteurs et des consommateurs, provoqué la disparition de nombreuses petites exploitations, et donc aggravé le chômage, accentué les déséquilibres entre régions et la désertification rurale, entraîné la perte de fertilité des sols, détruit des paysages bocagers, causé la diminution de la qualité des produits alimentaires, augmenté le coût du stockage de certains produits, favorisé la mainmise de quelques grandes firmes sur les réserves génétiques, compromis l’autosuffisance alimentaire du Sud, le tout en absorbant la moitié du budget européen.
Autrefois, le paysan était asservi au notable, il l’est désormais à l’argent.
Hier, la fonction de l’agriculture était de nourrir les hommes ; elle est aujourd’hui de réaliser des profits.
 On peut, là aussi, développer une des conséquences annoncées : la mise à mal de l’autosuffisance alimentaire du Sud, en ce qu’elle concerne un vol de terres qui peut se résumer par la formule « quand la vache du riche affame le monde ».
On peut, là aussi, développer une des conséquences annoncées : la mise à mal de l’autosuffisance alimentaire du Sud, en ce qu’elle concerne un vol de terres qui peut se résumer par la formule « quand la vache du riche affame le monde ».
40% des céréales cultivées dans le monde sont destinées à l’alimentation du bétail.
Plus des trois-quarts des terres agricoles sont consacrées aux animaux d’élevage.
Pour récupérer une calorie d’origine animale, il faut en moyenne sept calories d’origine végétale.
Il y a bien concurrence entre l’alimentation animale et l’alimentation humaine. Il a été calculé que l’Europe utilise sept fois sa superficie agricole en terres du « tiers monde » pour la production d’aliments destinés au bétail. On peut considérer que (presque) chaque habitant des pays industrialisés est « possesseur » d’un morceau de terre dans les pays pauvres. Il s’agit bien d’un vol.
Troisième étape : la terre, matière première capitale, objet de spéculation
La crise alimentaire est sans doute la principale cause d’un phénomène qui s’accélère depuis plusieurs années, l’accaparement des terres – achats ou locations – notamment agricoles, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Ukraine, par des gouvernements ou des entreprises privées (agroalimentaire ou secteur financier), soit pour assurer leur sécurité alimentaire, soit en tant qu’investissement. Dans de nombreux cas, ces terres sont présentées, bien entendu, comme « inutilisées », « dégradées » ou « sous-exploitées », alors qu’elles sont, au moment de leur acquisition, utilisées par des familles pauvres qui y cultivent les produits dont elles se nourrissent. La réalité, c’est que ces accapareurs cherchent plutôt des terres fertiles avec une certaine disponibilité en eau, la proximité des infrastructures, un potentiel de croissance de la production agricole, une politique foncière favorable, et si possible une main-d’oeuvre bon marché et peu au fait de ses droits. La « réalisation d’infrastructures », la « création d’emplois et de richesses », le « transfert de technologie », la « préservation de zones d’intérêt écologique » ne sont que des prétextes. Le résultat, c’est que les Etats les plus pauvres finissent par brader leurs ressources foncières. La terre devient donc une valeur refuge sans risques excessifs. Les principaux acheteurs actuels sont les Etats du Golfe (qui importent de 69 à 90% de leur nourriture), la Chine (qui doit nourrir 1,4 milliard de bouches, soit près du quart de la population mondiale, avec seulement 7% des terres arables), l’Inde, la Corée du Sud, l’Afrique du Sud…
Bien que, par manque de transparence, la quantité disponible de données fiables et détaillées dans ce domaine soit faible, on estime qu’au cours des dix dernières années, plus de 200 millions d’hectares de terres agricoles dans les pays dits en développement ont fait l’objet de négociations avec les investisseurs internationaux (une superficie équivalente à huit fois la taille du Royaume-Uni), les deux tiers se situant en Afrique subsaharienne. Le manque de devises et d’infrastructures agricoles modernes favorise ces transactions, lesquelles sont généralement arrangées par des intermédiaires locaux qui empochent évidemment de substantielles commissions. Alors que dans ces pays, près d’un milliard de personnes manquent de nourriture et un autre milliard souffre de formes diverses de malnutrition ; la hausse des prix alimentaires, depuis 2008 puis à nouveau fin 2010, venant aggraver la crise, notamment dans la Corne de l’Afrique. Et rappelant combien l’accès à la terre est essentiel pour des centaines de millions de ménages vivant en situation d’insécurité alimentaire. Non seulement l’accaparement des terres aggrave le problème de la faim, mais il condamne souvent au chômage et à l’exode, dévitalisant le tissu économique des zones rurales, exacerbe la pauvreté et les conflits, perturbe la vie sociale et culturelle des populations, contribue à la perte des connaissances et savoir-faire agricoles, accroît l’impact écologique. Il devient de plus en plus difficile et dangereux de vivre de la terre. Or les agricultures paysannes et familiales sont les mieux placées pour répondre aux besoins alimentaires des populations, pour assurer une production vivrière agro-écologique.
La production alimentaire et fourragère n’est pas le seul moteur de ces transactions foncières. Ces terres sont également achetées pour la production d’agrocarburants, galvanisée par les politiques de soutien à ces agrocarburants aux Etats-Unis et dans l’Union européenne. Ou pour effectuer des plantations dont l’objectif est de bénéficier de crédits carbone. Ou encore pour viser le contrôle de ressources stratégiques en anticipant les pénuries ou les tensions à venir (c’est-à-dire des immobilisations foncières avec l’idée de s’approprier les richesses du sous-sol).
 La ruée vers les terres n’est pas un fait vraiment nouveau : dès la fin des années 1980, la libéralisation croissante des mouvements de capitaux et des législations nationales incite les grandes entreprises à acheter des terres. Mais c’est la première fois dans l’histoire que le phénomène est complètement mondialisé. Et ce phénomène, qui commence à ressembler à un Monopoly planétaire, voire à un néocolonialisme agraire, ne peut que s’amplifier dans les années à venir, plusieurs processus conjuguant leurs effets : la demande grandissante de denrées alimentaires due surtout à la croissance économique des pays émergents (et notamment l’évolution des régimes carnés) et aussi à l’accroissement de la population mondiale – plus de 70 millions d’individus nouveaux chaque année) ; l’accélération du changement climatique (avec des incidences plutôt négatives sur la production alimentaire) ; la raréfaction de la ressource en eau (l’agriculture consomme 70% de cette ressource) ; le développement, on l’a vu, des agrocarburants ; la spéculation sur le foncier. Autant de facteurs qui risquent de rendre, dans un avenir proche, les conditions de vie très inconfortables, voire intolérables, pour une grande partie de l’humanité.
La ruée vers les terres n’est pas un fait vraiment nouveau : dès la fin des années 1980, la libéralisation croissante des mouvements de capitaux et des législations nationales incite les grandes entreprises à acheter des terres. Mais c’est la première fois dans l’histoire que le phénomène est complètement mondialisé. Et ce phénomène, qui commence à ressembler à un Monopoly planétaire, voire à un néocolonialisme agraire, ne peut que s’amplifier dans les années à venir, plusieurs processus conjuguant leurs effets : la demande grandissante de denrées alimentaires due surtout à la croissance économique des pays émergents (et notamment l’évolution des régimes carnés) et aussi à l’accroissement de la population mondiale – plus de 70 millions d’individus nouveaux chaque année) ; l’accélération du changement climatique (avec des incidences plutôt négatives sur la production alimentaire) ; la raréfaction de la ressource en eau (l’agriculture consomme 70% de cette ressource) ; le développement, on l’a vu, des agrocarburants ; la spéculation sur le foncier. Autant de facteurs qui risquent de rendre, dans un avenir proche, les conditions de vie très inconfortables, voire intolérables, pour une grande partie de l’humanité.
Que faire face à cette privatisation de l’espace, à cette marchandisation du vivant ?
D’abord, l’histoire montre que des luttes ont toujours été menées contre l’exploitation et la domination. Un peu partout, de nombreuses jacqueries porteront des revendications vers plus de dignité (réduction des charges, abolition du servage…). Mais parce que les participants étaient toujours mal organisés, mal équipés, ces soulèvements ont toujours été réprimés par la force, comme dans les Midlands en 1607 suite à la clôture des communaux, où une cinquantaine de paysans ont été pendus. Il reste que ces révoltes ont marqué l’émergence du peuple en tant que force politique.
Pour la suite de l’histoire, il faut rappeler que si la nuit du 4 août (1789) libère les paysans de servitudes intolérables, elle ôte également toute limitation à la propriété. Le 26 août, l’article 17 de la Déclaration des Droits de l’homme consacrera la propriété comme un « droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé ». Ce n’est qu’avec la reconnaissance du droit d’association, et grâce aux luttes ouvrières, que se développent à partir de la fin du 19e siècle de nouvelles formes de solidarité : syndicats, coopératives, mutuelles.
Le syndicalisme agricole, toutefois, est largement dessiné, en France, par la toute-puissante FNSEA dont les racines plongent dans l’extrême-droite et le régime de Vichy, et qui s’est toujours compromise dans la cogestion avec le pouvoir en place. A partir des années 1965-1967, certains syndicalistes vont analyser les conflits de la France rurale en termes de lutte des classes – les travailleurs-paysans. Estimant que les industries agroalimentaires et les « coopératives » contribuent à l’exploitation et à la prolétarisation des paysans qui doivent augmenter constamment le volume de leur production afin de préserver leurs revenus, ils prônent une alliance avec les ouvriers (ils lutteront d’ailleurs aux côtés des salariés dans les conflits de Lip et du Joint français).
Au niveau international, Via Campesina coordonne les luttes de plus de 70 organisations de paysans, de travailleurs agricoles, de femmes rurales, de communautés indigènes provenant des cinq continents avec des objectifs tels que l’amélioration des conditions de vie, la participation des femmes à la vie politique, sociale, économique, la souveraineté alimentaire, la propriété collective de semences, la protection de l’environnement…

Aujourd’hui, les luttes n’ont pas nécessairement faibli : au Mexique, au Brésil, au Chili, au Honduras, des populations se battent pour récupérer et occuper de bonnes terres cultivables, être reconnus en tant que peuples, disposer d’un territoire autonome. Mais les moyens dont dispose l’adversaire sont devenus considérables : ressources financières, pouvoir médiatique, renforcement de la propriété intellectuelle, protection juridique, brevets sur les logiciels ou sur les inventions, recours à l’armée. Le capitalisme investit tous les domaines. L’aspect le plus grave est sans doute le fait que les firmes biotechnologiques visent le monopole de la production de semences en lançant sur le marché des espèces dont elles détiennent les brevets. Or cette course aux brevets est l’aboutissement d’un processus qui a débuté, on l’a vu, il y a cinq siècles, celui de l’appropriation et de la privatisation des écosystèmes, de la biosphère. De la propriété privée des moyens de production à celle des moyens de reproduction, la boucle est bouclée !
Concernant la terre, qui forme le bien le plus ancré dans la propriété privée, tous ces combats buttent sur le foncier. Si les populations paysannes ont su arracher des réformes agraires, c’est parce que le souci des dirigeants était le maintien de la paix sociale. Mais chaque fois, les gouvernements ont été contraints d’enclencher des contre-réformes agraires sous la pression des gros propriétaires, du néolibéralisme, du capitalisme financier. Dans les pays pauvres, les programmes d’ajustement structurel ont signifié la fin du soutien des Etats au secteur agricole vivrier au profit du secteur agro-exportateur. Cette situation se prolonge aujourd’hui avec l’appropriation massive des terres agricoles à des prix dérisoires. La collusion entre les Etats et le capitalisme doit apparaître clairement.
Tant que les mouvements de lutte se limiteront à exiger des négociations sur la sécurité alimentaire, des mécanismes d’intervention sur les marchés, un moratoire sur les investissements à grande échelle dans le foncier ou sur les OGM, les paysans continueront à mourir sous les balles ou à se suicider, acculés à la faillite et à la misère. Les peuples n’auront que ce qu’ils prendront.
Chacun sait pertinemment qu’aucun gouvernement ne mettra en œuvre une réelle réforme agraire dans l’égalité. Et de toutes façons, l’égalisation d’un jour ne serait que le point de départ d’une nouvelle course à l’inégalité des fortunes. Même à dose homéopathique, le capitalisme est mortel. C’est la raison pour laquelle Gracchus Babeuf, partisan de l’égalité sociale et de la propriété collective, s’était opposé à la réforme agraire après la révolution : « La loi agraire, ou le partage des campagnes, fut le vœu instantané de quelques soldats sans principes, de quelques peuplades mues par leur instinct plutôt que par la raison. Nous tenons à quelque chose de plus sublime et de plus équitable, le Bien Commun ou la communauté des biens ! Plus de propriété individuelle des terres : la terre n’est à personne. Nous réclamons, nous voulons la jouissance communale des fruits : les fruits sont à tout le monde. » (Manifeste des Egaux)
Comme le soulignait Proudhon, la propriété est le problème « le plus grand que puisse se proposer la raison, le dernier qu’elle parviendra à résoudre. » Pour y parvenir, non seulement les populations ne pourront compter que sur leurs propres forces, mais il faudra que ces forces soient décuplées : courage, volonté, détermination pour privilégier la coopération par rapport à l’individualisme. Rien moins que d’inverser le cours de l’histoire. La mise en commun des terres et leur gestion collective, c’est ce qu’une partie du peuple espagnol avait osé faire pendant la Révolution de 1936. Alors pourquoi ne pas suivre cet exemple ?
Jean-Pierre Tertrais
Blog des groupes Lochu et Ferrer de la Fédération Anarchiste, 20 janvier 2012
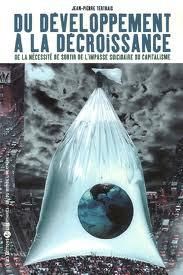 ndPN : pour plus d’infos sur la décroissance libertaire, lire « Du développement à la décroissance »
ndPN : pour plus d’infos sur la décroissance libertaire, lire « Du développement à la décroissance »