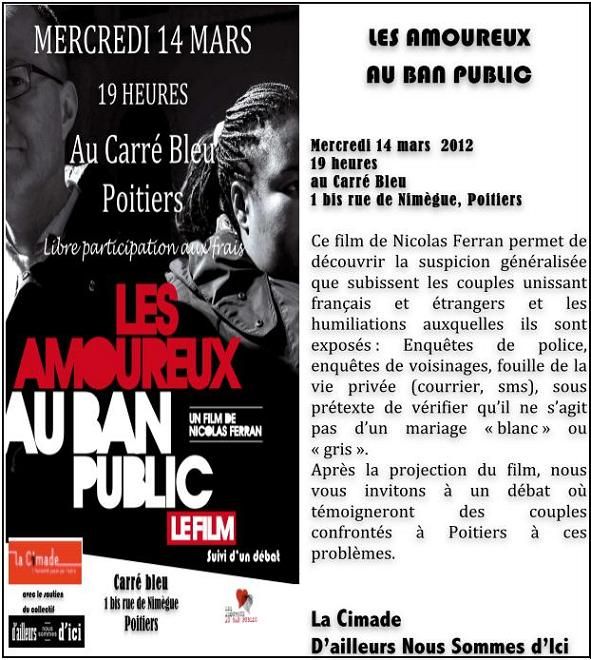Pour l’année 2011, un groupe indépendant de scientifiques pointe 15 dysfonctionnements dans treize centrales nucléaires étatsuniennes, et parle de « problèmes graves évités de justesse »… soit « plus d’un par mois » !
Pour l’année 2011, un groupe indépendant de scientifiques pointe 15 dysfonctionnements dans treize centrales nucléaires étatsuniennes, et parle de « problèmes graves évités de justesse »… soit « plus d’un par mois » !
L’industrie nucléaire américaine accusée de laxisme par des experts indépendants
Laxiste, l’industrie nucléaire américaine accumule les déficiences qui pourraient avoir des conséquences graves, accuse mardi un groupe indépendant de scientifiques privés, qui juge aussi que la Commission fédérale chargée de réglementer le secteur manque de poigne.
Dans son rapport, l’Union of Concerned Scientists (UCS) indique que quinze dysfonctionnements et pratiques risquées ont été signalés en 2011 dans 13 des 104 réacteurs nucléaires en service aux Etats-Unis.
Ce document examine en détail des « problèmes graves évités de justesse » et évalue la réponse de la Commission américaine de réglementation nucléaire (Nuclear Regulatory Commission ou NRC).
« Un grand nombre de lacunes significatives de sécurité dans les centrales nucléaires aux Etats-Unis en 2011 se sont produites parce que les propriétaires, mais aussi souvent la NRC, ont soit toléré des problèmes connus ou n’y ont pas répondu de façon adéquate », écrivent les auteurs de ce document de 45 pages.
Il décrit des inspections spéciales menées par la NRC en réponse à 15 problèmes de sécurité posés par des équipements et des déficiences.
« Aucun de ces 15 problèmes potentiellement graves n’a blessé des employés ou la population mais leur fréquence, de plus d’un par mois, est élevée pour une industrie ayant atteint sa maturité », jugent ces experts.
Parmi ces incidents, le rapport cite la centrale d’Oconee en Caroline du Sud (sud-est) où les services d’entretien ont découvert en 2011 qu’un système de refroidissement de secours du coeur des réacteurs, installés en 1983, n’aurait jamais fonctionné en cas de nécessité, vu que les coupe-circuits étaient mal réglés.
L’UCS souligne que cette centrale est identique à celle de Three Mile Island en Pennsylvanie (est) dont l’un des réacteurs avait subi une fusion partielle en 1979 en raison d’un dysfonctionnement du système de refroidissement.
Le rapport dénonce également les centrales nucléaires de Braidwood et Byron dans l’Illinois (nord). Le personnel d’entretien avait, depuis 1993, institué une pratique consistant à utiliser l’eau des circuits vitaux de refroidissement des réacteurs pour des pompes auxiliaires.
Cette pratique visait à ne pas utiliser les eaux non traitées d’un lac afin de réduire la corrosion. Mais en cas d’urgence, le système de refroidissement n’aurait pas pu fonctionner normalement en raison d’un manque d’eau, souligne l’UCS.
« Le bilan 2011 montre que la NRC est tout à fait capable d’être une agence efficace de surveillance qui protège la population et empêche l’industrie nucléaire de céder à ses pires penchants », estime Dave Lochbaum, directeur du projet de sécurité nucléaire à l’UCS et principal auteur du document.
« Mais trop souvent, l’agence n’est pas à la hauteur de son potentiel », estime cet ingénieur nucléaire qui a travaillé 17 ans dans des centrales.
Il cite de « nombreuses défaillances persistantes qui pourraient trop facilement provoquer un grave accident », pointant du doigt le fait que la NRC ait laissé subsister des problèmes pendant plusieurs décennies.
Le rapport souligne que 47 des 110 réacteurs américains ne se conforment toujours pas aux réglementations anti-incendie établies par la NRC en 1980. La NRC est également consciente que 27 réacteurs restent en service même si leurs systèmes de sécurité ne sont pas conçus pour résister suffisamment à des séismes, selon le rapport.
« Les accidents de Three Mile Island en 1979, de Tchernobyl en 1986 et de Fukushima en 2011 se sont produits quand une poignée de problèmes connus et non-corrigés ont abouti à une catastrophe », a averti Dave Lochbaum, disant craindre que « l’industrie nucléaire américaine et la NRC n’aient rien appris de ces accidents et qu’un jour la chance leur fasse défaut ».
AFP, 28 février 2012