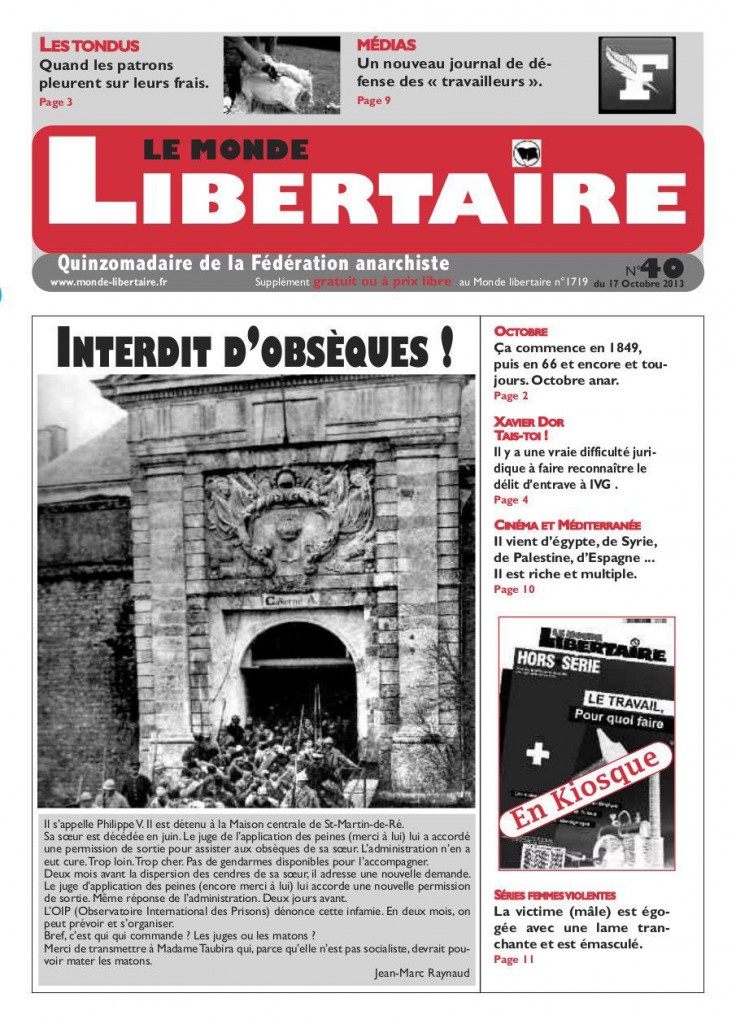Réponse au texte « La question du droit en anarchie – Ses sources, la justice et la police », de Pierre Bance
Pierre Bance a proposé un nouveau texte sur Grand angle libertaire, sur les formes que pourraient prendre le droit, la justice et la police en société anarchiste. C’est un texte dérangeant – dans le meilleur sens du terme, parce qu’il pose de nombreuses questions, et que ça fait toujours du bien de se secouer les puces. Si les anarchistes ont toujours combattu l’Etat, qui repose en pratique sur ces dispositifs régaliens, comment régler autrement nos conflits ?
Or nous n’avons pas attendu ce texte pour tenter de résoudre nos conflits. La question la plus intéressante à mon sens, celle que me pose en tout cas ce texte, ne consiste pas à me demander quelles formes pourraient adopter le droit, la justice ou la police en « anarchie » (en « société anarchiste »). La question la plus intéressante, c’est pourquoi un tel texte, ce qui m’a conduit à me questionner sur les rapports entre anarchie et anarchisme. Sur l’anarchie en tant que société instituée, et sur l’anarchisme en tant que dynamique sociale.
Pierre Bance l’annonce dès le début du texte : il s’agirait de faire des propositions, démonstrations, explications et descriptions, acceptables par le plus grand nombre, bref il s’agirait pour nous d’être crédibles, au lieu de nous cantonner à l’incantatoire. Il s’agirait aussi de nous préparer, en cas de mouvement révolutionnaire, à énoncer des propositions réalistes, alternatives au droit bourgeois, en vue de « l’application » d’une politique alternative. Il s’agirait, en somme, de nous engager dans une nécessité de décrire ce à quoi pourrait ressembler l’anarchie, au sens de société anarchiste, avant même d’y être, si tant est que nous y soyons un jour.
Or ces deux intentions du texte me posent problème en elles-mêmes. Je ne souhaite pas être crédible par des propositions, mais par la pratique anarchiste collective dans laquelle je m’inscris ici et maintenant. Si cette pratique collective nous épanouit, nous nous renforçons, aussi bien en nombre qu’en possibilités concrètes de changer nos vies. Si elle nous plombe le moral et nous embourbe, nous ne risquons pas de nous renforcer… et tant mieux, parce qu’à la tristesse de ce monde, nous ajouterions alors la tristesse de formes d’organisation inadéquates. Il ne s’agit pas d’être crédibles, c’est-à-dire de susciter une foi en quelque chose de futur, mais d’agir dans le présent. Je ne nie pas la nécessité que se répandent des pratiques anti-autoritaires, mais la seule propagande par des mots ou des propositions est inutile. Les actes sont toujours plus « crédibles » que les mots, parce qu’ils ne demandent pas aux autres de croire, mais leur proposent d’agir avec nous dans quelque chose qui existe déjà. Nous le constatons au quotidien.
D’autre part, et cela va avec, je ne souhaite pas « appliquer » à « la société » mes vues. C’est aux concernés eux-mêmes de développer leurs pratiques, adaptées ou non des pratiques que nous mettons en place, et cette inspiration, cet échange d’expériences, ne peut dépendre de fait que de notre capacité à résoudre les problèmes que nous vivons ici et maintenant, à l’échelle sociale aussi bien qu’à l’échelle de nos petites organisations formelles ou informelles. Le fait que Pierre Bance recourt aux mots de démocratie et de majorité, s’inscrit dans une tendance hélas largement partagée, y compris chez les anarchistes d’aujourd’hui, à n’imaginer les choses que selon les logiciels mêmes qu’ils combattent : « la société » unique, et non infiniment multiple ; la « démocratie » comme légitimation des majorités ou de leurs représentants (y compris mandatés de façon impérative et révocable) de contraindre des minorités à des décisions. A cet égard, l’exemple du « Code de la route » donné par Pierre Bance, comme d’autres donnent celui du train pour tenter de légitimer la nécessité de fonctionnements démocratiques parfois contraignants (il s’agit quand même de dégager des habitants et de massacrer des paysages), lui aussi abstrait des conditions économiques et politiques présidant à la mise en oeuvre de ces technologies loin d’être socialement neutres, est significatif. Personnellement, j’ai abandonné ma voiture et je considère le système de l’automobile comme un suicide social et écologique, que je combats, c’est pourquoi j’essaie de faire autrement, à la mesure de mes forces individuelles et des solutions collectives que je tente de trouver avec mes amis quand je souhaite me déplacer et les rencontrer. Cela ne veut pas dire que je n’y recours pas de temps à autre ni que je condamne les automobilistes, ce qui serait stupide : je ne suis pas abstrait du monde de domination où je vis. Je veux seulement dire que je m’inscris dans une dynamique, aussi bien de lutte que d’affirmation, ici et maintenant, contre un modèle destructeur socialement et écologiquement, qui nous a été imposé.
D’autre part l’anarchie, c’est-à-dire une société anarchiste, constituée, pour ne pas dire un Etat anarchiste où tout serait parfait, où tout serait figé, cela ne m’intéresse pas. Au nom de quoi d’ailleurs, aurais-je la prétention de révéler aux autres un modèle de société sorti de mon chapeau, dans laquelle ils vivraient mieux ? Je ne veux tout simplement pas d’un monde parfait, et s’il m’arrive de rêver, je fuis toute projection dans un monde rêvé et abstrait à plaquer sur notre réalité présente. Je me défie des idéologues, fussent-ils autoproclamés anarchistes. La « révolution » est ici et maintenant, et la fameuse « phase de transition » l’est aussi. Je me méfie de tout modèle de société future, d’autant plus s’il s’abstrait des situations que nous vivons ici et maintenant, desquelles nous nous dépêtrons comme nous pouvons, et que nous transformons pragmatiquement, à la mesure de nos besoins et de nos forces.
Je ne crois pas non plus aux « anarchistes », et me vois mal me définir anarchiste contre des méchants autoritaires, non seulement parce que je me connais trop bien pour me prétendre débarrassé de mes aliénations mentales et de mes sales habitudes, mais parce que l’anarchisme désigne, dans son sens premier lui-même, une dynamique vers d’autres relations sociales, tendant à foutre par terre les rapports de subordination, de sujétion, d’exploitation, explicites ou tacites. Tout seul, je ne suis ni anarchiste ni autoritaire. C’est avec les autres que je construis des relations différentes, transformant des rapports de domination en des liens solidaires. Et ces relations ne sont jamais totalement libres, ni totalement autoritaires : elles sont infiniment plus complexes que cela, et se travaillent. C’est à chaque individu et à chaque collectif, dans sa relation et son interdépendance aux autres, qu’il subit ou qu’il impose, malgré lui ou de son plein gré, qu’il incombe de réfléchir et d’agir, de lutter, de s’affirmer. Je préfère donc le mot anarchisme, comme dynamique sociale de construction de liens solidaires, de transformation de la nature des relations actuelles, qui sont des rapports marchands et de domination. C’est une dynamique toujours vivante, jamais acquise pour toujours, parce qu’à toute situation nouvelle, il y a de nouvelles questions et problèmes, et des réponses nouvelles du collectif, plus ou moins adéquates, et jamais totalement prévues. Nous ne pouvons pas nous reposer sur autre chose que nous-mêmes.
Or le droit, la justice et la police sont des façons de « régler » les conflits qui vont intrinsèquement à rebours d’une dynamique anarchiste collective, parce qu’ils sont indissociables de l’Etat, au sens de système de domination sociale. En imposant une règle, ils nous empêchent de nous régler les uns avec les autres, de nous organiser de façon pragmatique pour solutionner nos problèmes et démultiplier notre puissance. Ces institutions sont la traduction de l’aliénation collective, et les outils de la dépossession sociale et politique. De même que la monnaie, elle aussi évoquée par Pierre Bance. Elles n’existent que par défaut, comme l’ombre de notre incapacité collective, comme le revers de ce que nous ne parvenons pas à vivre ensemble dans l’épanouissement mutuel et la solidarité. Ce sont des institutions figées, calcifiées, personnifiées et donc dépersonnificatrices, incapables de résoudre les questions toujours nouvelles que pose et se pose la société réelle, au sens de l’ensemble des relations entre les humains, et les relations que ceux-ci entretiennent avec leur environnement.
Les solutions du passé ne seront jamais entièrement adaptées à celles de demain. Sans questionnement collectif permanent, le marbre du droit apparaît, avec ses cohortes de « représentants » politiques ès législation, ses partis et leurs programmes péremptoires. Sans responsabilisation individuelle et collective permanente, la spécialisation judiciaire en juste, en adéquat et en textes sacrés apparaît, avec ses armées de juges, de procureurs, d’avocats. Sans solidarité permanente, aussi bien en amont qu’en aval des conflits inévitables et même nécessaires, la répression physique et psychologique apparaît, avec ses forces armées, ses soldats, ses flics et ses prisons, mais aussi ses spécialistes de la gestion caritative et paternaliste. Nous pourrions aussi parler de l’éducation nationale, qui n’impose son bourrage de crâne et sa vision magistrale de l’apprentissage que là où nous ne parvenons pas à mutualiser nos savoirs et nos savoir-faire, dans un réseau d’éducation populaire et libertaire.
Je me méfie de l’anarchie, je me méfie de tout programme ; je suis dans l’anarchisme, du mieux que je peux. Penser qui plus est à l’anarchie en recourant, pour être crédibles (mais pour quelle raison éprouverions-nous même le besoin de l’être ?), à des pratiques et des méthodes constitutives de ce que nous combattons, montre bien que sans pratique réelle, ici et maintenant, nous nous condamnons à penser le futur de façon étriquée et du reste, pour le coup, tout aussi peu convaincante que réductrice du présent.
Il ne s’agit pas de s’abstraire du monde présent, par l’incantation et un volontarisme élitiste ou l’appel à une désertion totale complètement illusoire. Bien sûr que le droit, la justice, la police, la monnaie et la voiture existent et modèlent ce monde et ma vie, dans un combat permanent de ces institutions morbides avec les forces collectives de l’émancipation sociale. J’ai parfois eu recours au droit, à des juges, et il m’arrivera peut-être de recourir aux flics en cas de problème insoluble par manque de force collective. Il m’arrive de conduire une voiture et j’utilise presque tous les jours de la monnaie pour me procurer certaines choses dont j’ai besoin. Hélas ; et il y a bien d’autres contradictions encore dans ma vie, entre ce qui existe et ce que je souhaiterais vivre, notamment dans la sphère des questions affectives. Mais j’ai aussi envie, en permanence, de vivre et de faire autrement, et je m’organise pour cela, pour lutter et vivre autrement. Pas tout seul, pas seulement en prenant ma plume, mais avec les autres qui, eux aussi à leur mesure, luttent et expérimentent autre chose, en partant de leurs désirs. Et je n’ai pas envie de mettre de l’eau dans ce bon vin qui m’enivre, pas envie de couvrir de plus de merde encore cette poésie qui circule entre nous.
Juanito, groupe Pavillon Noir (FA 86), 11 octobre 2013