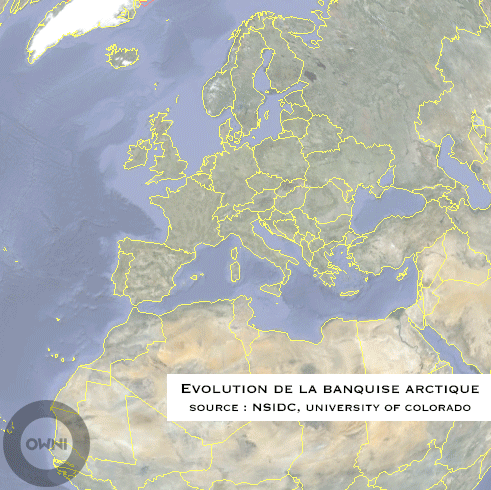NdPN : encore une fois, les promoteurs de la ligne à grande vitesse (LGV) Tours-Bordeaux, ruineuse financièrement, socialement, écologiquement, lui cherchent de pauvres justifications : elle créerait des « emplois », et de « l’insertion » (sic). Encore merci au député-maire « socialiste » Claeys, qui se « bat » pour la LGV. Et à toutes les centrales syndicales invitées par Vinci à collaborer, à se jeter sur ce chantier comme des mouches pondant sur une belle merde, pour se faire une place au soleil dans les instances de construction du désert. Course répugnante de bureaucrates opportunistes, briguant le droit à « représenter » les forçats qui vont trimer sur ce chantier.
Fin du débat ?
D’une part, si l’on veut bien faire l’exercice écoeurant consistant à rentrer dans l’obscure logique capitaliste de ses promoteurs, la création effective d’emplois à long terme n’est pas une évidence, loin de là : les subventions bloquées pour ce projet sont autant d’argent qui n’est pas investi dans d’autres types de projets, qui pourraient créer d’autres emplois. De plus, le fait même qu’une LGV existe implique fatalement une baisse d’activités dans toutes les vastes zones rurales traversées, et d’autant moins desservies.
D’autre part, faut-il créer des « emplois » à tout prix ? Nous ne le pensons pas. Les capitalistes ont recours au salariat parce que c’est le moyen d’accroître leurs profits et leur emprise sur les classes sociales qui ne peuvent survivre qu’en se vendant, en abdiquant leur force de travail. Celle-ci ne servira qu’à accroître la part du capital, et donc mécaniquement, à baisser à terme celle des salaires, suivant cette bonne vieille logique de « crise » inhérente au capitalisme. La seule « insertion » que développe cette propagande de l’emploi, c’est d’intégrer les populations à l’idéologie du travail salarié, de la soumission généralisée. La seule « insertion » que propose la LGV, comme dans tous les grands chantiers inutiles imposés aux forceps de la répression brutale des opposants (ligne THT dans la Manche, aéroport de Notre-Dame-des Landes, autoroutes..), c’est l’insertion du capitalisme dans nos vies, dans une logique de colonisation de l’espace écologique et social. Le fait qu’une ligne LGV Poitiers-Limoges soit encore soutenue, alors que les budgets manquent, démontre que le projet de LGV correspond bien à cette logique de colonisation.
Car le travail suscité par ces emplois, à savoir une ligne TGV, pose lui-même question : comme presque toutes les productions industrielles de notre triste époque, le fruit de ce travail est socialement et écologiquement nuisible. Est-ce un progrès social que de produire un dispositif de plus dans le réseau marchand qui enserre toujours plus nos vies ? Qui isolera un peu plus les zones rurales, détruira davantage notre environnement en le tronçonnant, en le mutilant d’une barrière de plus, en massacrant la biodiversité, en transformant nos campagnes en désert ? Qui sollicitera toujours plus d’énergie électrique, c’est-à-dire d’énergie nucléaire, avec son lot d’irradiations, de risques majeurs croissants, de déchets dangereux et ingérables, à gérer par un nombre de générations qui nous succèderont équivalent au nombre de celles qui nous sépare de l’australopithèque Lucy ?
Pour rire jaune, on consultera l’article de la presse locale… avec une photo d’illustration qui montre (sans doute bien involontairement) le vrai visage de « l’insertion » : un paysage dévasté par des machines, pour rien, pour du néant. Elle a belle gueule, « l’insertion » !
Plus le mensonge est énorme, plus il est grotesque.
Grand Poitiers s’engage pour l’insertion

Sur le chantier de la LGV, comme ici à Migné-Auxances, des entreprises d’insertion vont pouvoir intervenir.
La collectivité veut favoriser l’emploi par l’insertion en direction des personnes en grande difficulté. Elle va dans ce sens signer un accord avec la SNCF.
En cette période de gros temps sur le front du chômage, toute initiative en faveur de l’emploi est la bienvenue. Hier soir, lors du conseil communautaire de Grand Poitiers, on a parlé insertion. Autrement dit de la prise en charge des personnes éloignées du marché du travail, de la manière dont on peut aider les entreprises qui les emploient, enfin de la façon dont les collectivités locales, à travers leurs marchés publics, s’engagent dans cette voie.
On a ainsi appris que Grand Poitiers allait signer un accord de confidentialité avec la SNCF sur ces clauses d’insertion. Ceci concerne le grand chantier de la LGV qui représente à lui seul actuellement quelque 2.000 emplois. De nombreux autres chantiers sont ainsi mis en place à travers le Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) Celui-ci travaille avec un réseau d’entreprises, une trentaine, qui sollicitent régulièrement ses services. Ce fut par exemple le cas dernièrement sur le chantier de réhabilitation de la Ganterie. Quelque 27 personnes y ont travaillé, majoritairement sur des postes de manœuvre. Entre le 1er juin et le 30 juin 2012, plus de 25.000 heures d’insertion ont été réalisées et ce sont 113 personnes qui ont bénéficié d’un contrat de travail.
Le chantier de la LGV et de La Ganterie
En 2011, le Plie avait accompagné 723 personnes. Parmi elles, 280 avaient décroché un CDD, 80 un CDI, 310 des contrats d’intérim. Enfin, 49 autres étaient sorties du dispositif pour un contrat de plus de six mois.
à chaud
Le projet de ligne LGV Poitiers-Limoges s’invite au débat et Alain Claeys donne de la voix
> LGV Poitiers-Limoges. En ouverture des débats, le collectif « non à la LGV Poitiers-Limoges » est venu manifester et prévenir les élus communautaires. « Cette ligne ne sera jamais réalisée, la situation économique ne le permettra pas, a prophétisé Nicolas Bourmeyster, le président du collectif, à la tribune. Ne soutenez pas l’insoutenable, refusez ce projet ! »
Quand la délibération portant sur l’approbation de la participation de l’agglo au dispositif foncier à hauteur de 25.000 € (l’engagement total de la collectivité restant limité à 375.000 €) fut présentée, le débat prit corps. Transporté par le sujet les voies à grande vitesse, le président Alain Claeys donna de la voix. « J’y crois profondément. Ce combat, je le mènerai jusqu’au bout. Aujourd’hui où la croissance est au plus bas, on doit être capable de développer des grands projets. » S’enflammant, l’élu se lança dans une petite leçon d’histoire contemporaine. « Prenez les débats municipaux du XIXe siècle, combien de communes ont-elles laissé passer le train à cause de tels arguments ? On disait aussi que la LGV SEA ne se ferait pas… Il faut se battre, bon sang. L’opposition du rural contre l’urbain, c’est dépassé. Si Poitiers crève, le département crèvera. Et vice-versa. »
Maryse Desbourdes (NPA Poitiers) répliqua : « Je suis d’accord avec vous M. Claeys, il faut se battre. Mais, cette ligne… ne doit pas se faire ! Elle est inutile, onéreuse, socialement et écologiquement désastreuse. »
Stéphane Braconnier (UMP Poitiers) s’aiguilla dans les mêmes rails que le président. « C’est un projet qui doit être soutenu pour de multiples raisons dont beaucoup sont celles que vous avez développées M. Claeys. » « Je ne suis pas convaincu de la pertinence de cette LGV, argumenta Patrick Coronas (PCF, Poitiers) […] Le ministre du Budget a prévenu : « Il faudra élaguer, le gouvernement n’aura pas d’autre choix que d’abandonner certains prochains projets » […] Il serait donc peut-être prudent de ne pas trop investir en attendant d’être éclairé sur les décisions réelles de financement… » Philippe Brottier (PS, Fontaine-le-comte) conclut : « Si notre territoire ne veut pas de ce projet, d’autres saisiront cette chance. »
> Subvention à Brian Joubert. Revenant savoureusement sur la prise de bec avec la secrétaire de son groupe, Odile Chauvet lors du dernier conseil municipal :
« Je me risque à une intervention sur le sport, si nécessaire je demande la protection des agents de la Ville. » – Stéphane Braconnier a expliqué ainsi son vote contre la subvention accordée à Brian Joubert.
« Je comprends les motifs mais je suis très réservé dans lesquelles on verse 15.000 €
Pas de contrôle, pas de justificatifs demandés. Je trouve cela très léger. » Florence Jardin (Migné-Auxances) s’est abstenue.
Nouvelle République, J.-M.G., 29 septembre 2012